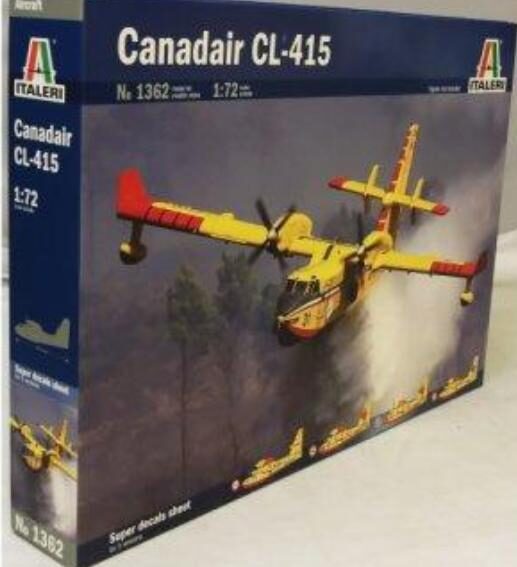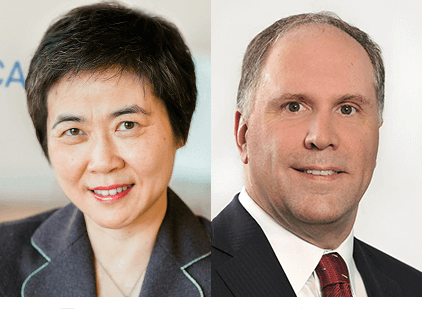Ce rendez-vous avait été donné dans la semaine suivant la clôture de l’historique COP 26 que l’ONU a tenue, en Écosse, sur les changements climatiques et la mise en application de l’Accord de Paris sur le climat. Bien des yeux de la planète y étaient tournés du 31 octobre jusque, finalement, au samedi 13 novembre. Sa thématique, elle aussi, était d’extrême importance : les 17 et 18, puis jusqu’au vendredi 19 novembre 2021 pour un gala d’excellence, il fallait s’être gardé de l’énergie pour visio-participer à des panels voués à accélérer le leadership des femmes dans l’agriculture. Femme et agriculture !
L’agriculture « (…) à l’ère de la quatrième révolution technologique! » insistera Sâadia Lakehal, déjà fière de nous annoncer « qu’une vingtaine de contrats en retombée » peuvent être mis au bénéfice de son second sommet mondial « AgriTech Au Féminin », ce après les deux précédents eux aussi bâtis sur l’enjeu et les potentiels de la révolution numérique, dites 4e Révolution industrielle.
C’est qu’elle en connaît quelque chose, dame Sâadia, entrepreneure continuellement au front depuis au moins une dizaine d’années animant, de Montréal, l’écosystème industrialisation-entrepreneuriat féminin-environnement/économie circulaire. Tantôt en dirigeant une association de parc industriel, tantôt en étant conférencière-experte dans des colloques internationaux.
Au surplus, particulièrement forte en réseautage international, ses invitées d’honneur, une dizaine, incluaient notamment: Josephine Joseph Lagu, ministre de l’Agriculture du Soudan du Sud; Josefa Leonel Correia Sacko, commissaire à l’économie rurale et à l’agriculture de la Commission de l’Union africaine; Jeminah Njuki, directrice Afrique à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI); l’ambassadeur Ertharin Cousin, fondateur de Systèmes alimentaires pour l’aveni; ainsi que Ndaya Beltchika, spécialiste technique principal – Genre et inclusion sociale au Fonds international de développement agricole (FIDA).
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET INCLUSION DES FEMMES
Organisé par Emperia Industries Connect, l’entreprise qu’elle a elle-même mise sur pied après une feuille de route déjà imposante, cette 2ème édition du Sommet Mondial Agritech au Féminin (GWIA21) avait pour thème : « Cultivons ensemble l’avenir ».
« Le sommet GWIA vise à dynamiser le leadership au féminin à l’ère de la quatrième révolution technologique et à donner la parole aux femmes qui ont un rôle à jouer pour le développement de l’agriculture 4.0 », explique Sâadia Lakehal.
Crises climatiques ou pas, l’enjeu de nourrir la planète est et reste un défi énorme. Si une conférencière est venue expliquer que l’humanité a présentement la capacité de nourrir jusqu’à 12 milliards d’humains, il s’agit d’une capacité, au-delà de la possibilité technique ou industrielle, qui devient théorique, lorsque confrontée aux réalités terrains tels que les taux de gaspillages alimentaires, les aléas de chaine d’approvisionnement ou de chaine de production, voire les impacts environnementaux ou variables climatiques.
Le système alimentaire mondial subit d’énormes transformations. Les objectifs d’une « production alimentaire responsable » ou d’une « sécurité alimentaire », ce encore plus à la suite de la pandémie en cours, figurent évidemment à l’ordre du jour d’un sommet privilégiant la place des femmes dans l’AgTech.
Tablant cette fois sur les liens de partenariat du Canada avec les Pays-Bas, avec des représentants de ces deux importants pays dans les domaines de l’agriculture mondialement, madame Lakehal a pu compter sur la participation de Marie-Claude Bibeau, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, pour une prise de parole officielle. Madame Meiny Prins y était l’invitée d’honneur pour les Pays-Bas.
Meiny Prins is CEO and co-owner of Priva. She was proclaimed Business Woman of the Year 2009 and received the first CleanTech Star of World Wildlife Fund for Priva, a high-tech company that develops hardware, software and services in the field of climate control, energy saving and optimal reuse of water.
Au surplus, particulièrement forte en réseautage international, ses invités d’honneur, une dizaine, incluaient notamment: Josephine Joseph Lagu, ministre de l’Agriculture du Soudan du Sud; Josefa Leonel Correia Sacko, commissaire à l’économie rurale et à l’agriculture de la Commission de l’Union africaine; Jeminah Njuki, directrice Afrique à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI); l’ambassadeur Ertharin Cousin, fondateur de Systèmes alimentaires pour l’aveni; ainsi que Ndaya Beltchika, spécialiste technique principal – Genre et inclusion sociale au Fonds international de développement agricole (FIDA).
INNOVER, CONNECTER, MOBILISER
La mission de l’événement était notamment de faire découvrir les perturbations au sein de l’industrie, d’identifier les bons modèles commerciaux pour accélérer la commercialisation des technologies avancées agricoles, de générer des partenariats et des collaborations à l’échelle mondiale.
Un Salon Agtech virtuel avait aussi été aménagé pour mettre en valeur les entreprises de hautes technologies en agriculture qui participaient au sommet, offrant au surplus un outil de réseautage avec les experts du secteur. L’événement, qui reviendra l’an prochain était en partenariat avec près d’une quarantaine d’entreprises internationales, canadiennes et québécoises, dont Sollio Groupe Coopératif, Financement Agricole Canada, la Zone Agtech, WOMA Marketing, rainMKRS, Evol, Industries Harnois, Geenfield Global, Priva, IICA, Dutch GreenHouse Delta et GBA.
Après la France en 2020 et les Pays-Bas en 2021, Sâadia Lakehal ne nous confirmait pas encore le pays partenaire avec lequel elle compte tenir son édition 2022, mais la région du Moyen-Orient semblait dans sa mire.
| DOSSIER SPÉCIAL À PARAÎTRE Février 2022 En partenariat avec Emperia Industries Connect , CommerceMonde publiera une série d’articles en lien avec le Sommet Mondial Agritech au Féminin (GWIA21) ainsi que sa prochaine édition de 2022. Vous voulez vous y joindre? Contactez nous. Annoncez ici – Cyberjournal Commerce Monde |
Les vidéos de l’événement sont disponibles sur demande.
(CRÉDIT PHOTO: prise d’écran de l’animatrice Sâadia Lakehal, lors du Gala du 19 nov. 2021.)