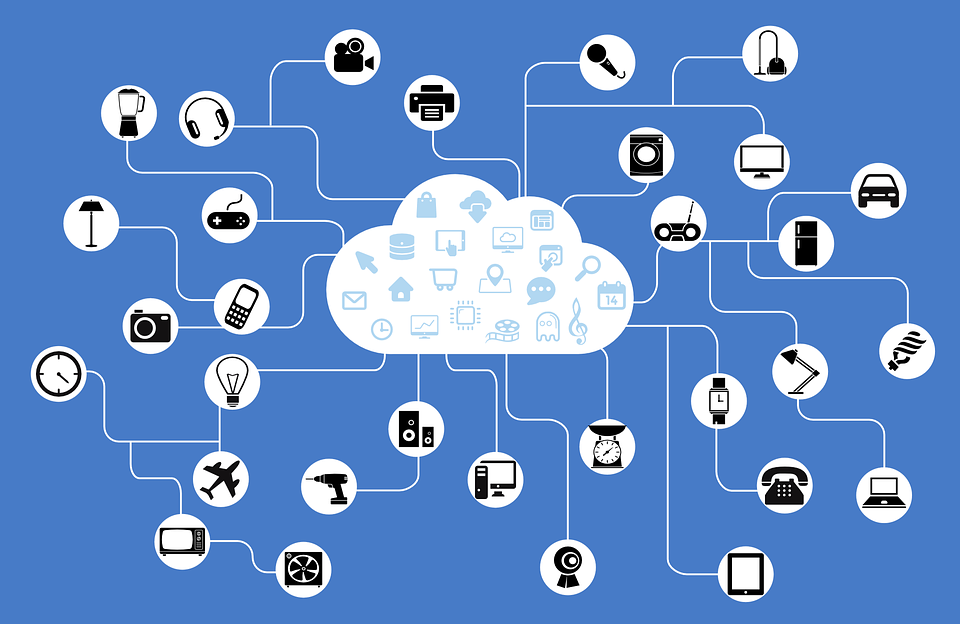Une récente analyse de l’industrie mondiale des centres de données véhicule de très gros chiffres. Elle pointe aussi l’intérêt pour le Canada: « un des marchés naturels les plus prometteurs au monde ».
« Aujourd’hui, l’industrie des centres de données mondiaux représente plus de 14 milliards $US, le Canada s’apprêtant à prendre plus de parts de marché, car il devient un incontournable pour les clients étrangers et nationaux, compte tenu des conditions propices offertes au pays. Le marché nord-américain représente près de la moitié du marché mondial, qui devrait augmenter à un TCAC de 12,1% d’ici 2018. Les exigences accrues pour l’infonuagique font que cette industrie doublera de taille au cours des 5 prochaines années », explique Roger Karam, le président de Northern Investment Partners.
C’est fort de cette analyse que Northern Investment Partners vient d’annoncer qu’elle avait établi un partenariat avec M Capital Group – MCG, une banque d’affaires ayant des bureaux à New York, Londres et Dubaï, pour investir jusqu’à 120 M $US en capitaux propres afin de poursuivre une stratégie de construction, d’exploitation et d’acquisition afin de tirer profit de l’une des opportunités de développement immobilier et technologique les plus dynamiques au monde, à savoir les centres de données. L’objectif est clairement « de fournir aux locataires AA et AAA la possibilité de loger leur infrastructure informatique avec une plateforme au Canada, un des marchés naturels les plus prometteurs au monde ».
Pourquoi spécifiquement au Canada ?
Au Canada en raison :
- des coûts énergétiques très bas,
- d’un climat froid,
- en plus d’un environnement politique stable,
- et de solides lois en matière de sécurité des données et de la vie privée.
Mais le Canada est aussi considéré comme l’un des marchés les plus concurrentiels pour héberger des centres de données à cause de l’avantage supplémentaire d’avoir une relation privilégiée avec le plus grand consommateur mondial de services de centres de données, les États-Unis.
« Sa proximité culturelle et son partenariat commercial en font une destination idéale pour les sociétés américaines », pense aussi Roger Karam.
« Northern poursuit une prometteuse stratégie de gestion de niche qui vise un taux de rendement interne (IRR) de 28%, avec des actifs immobiliers qui tireront parti d’une forte croissance dans le secteur de la technologie sans le risque associé. De plus ses contrats immobilisés stables offriront des flux de trésorerie avec des entreprises ‘blue chip’ à la fin de la construction avec recapitalisation possible après deux à trois ans (…)
Il s’agit d’une stratégie bien structurée qui nous permet, à nous et à nos partenaires aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, d’offrir des capitaux attrayants à UHWI, aux institutions et au SWF. Nous sommes enthousiastes de ce partenariat à long terme avec Northern », précise par communiqué Christian Mouchbahani, qui est directeur associé chez M Capital Group.
Northern Investment Partners Inc. est une société de gestion de placements dont le siège social est situé à Montréal. Sa stratégie vise à concevoir, exploiter et gérer des centres de données de gros, en se concentrant à priori sur Montréal. De son côté, M Capital Group est une banque d’affaires internationale qui procure une expertise en matière de savoir-faire en investissement, services bancaires, fusions et acquisitions, gestion d’actifs et de fonds, ainsi que des structures de financement alternatives.
*****
Vous aimez cet article! Faites une DONATION à la rédaction du cyberjournal par un clic au bas de la colonne de droite de cette page... MERCI !