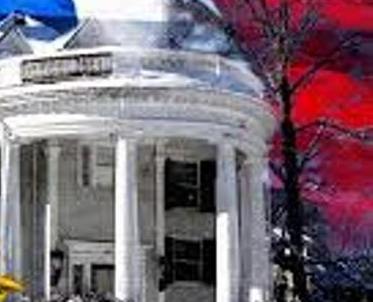Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent a décidé de poursuivre les efforts visant à réduire davantage le niveau élevé du lac Ontario. Son débit a été augmenté, passant de 10 200 m3/s à 10 400 m3/s le 14 juin. Ceci donne lieu au débit d’eau le plus élevé ne s’étant jamais écoulé continuellement du lac Ontario sur une période prolongée.
L’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent a conséquemment imposé des restrictions importantes liées à la navigation et pris des mesures de sécurité additionnelles pendant la période de débit élevé. Les plaisanciers sur le fleuve Saint-Laurent ont été informés du débit d’eau élevé et des forts courants.
Cependant, le niveau de l’eau du cours inférieur du fleuve Saint-Laurent à proximité de Montréal a continué de diminuer, malgré le débit accru loin en amont. Selon les observations actuelles, les répercussions additionnelles du débit élevé sont donc minimales. Le Conseil a ainsi décidé de continuer de maintenir un débit de 10 400 m3/s pour venir en aide à toutes les personnes touchées par ce haut niveau d’eau record du lac Ontario, sans toutefois aggraver les répercussions sur les autres intervenants de l’ensemble du réseau.
Le Conseil, la Voie maritime du Saint-Laurent, les responsables du barrage Moses-Saunders et les agences maritimes continueront de surveiller de près la situation et d’évaluer le niveau d’eau, les apports en eau et le débit durant cette période de conditions extrêmes.
DES NIVEAUX RECORDS
Le niveau du lac Ontario a diminué de 11 cm par rapport au sommet de 75,88 m enregistré le 29 mai. En aval, le niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent à la hauteur du lac Saint-Louis, non loin de Montréal, a diminué de 15 cm depuis le 12 juin. Le 19 juin 2017, le niveau d’eau du lac Ontario était de 75,77 m, soit 72 cm au-dessus de son niveau moyen à long terme pour cette période de l’année.
Le niveau du lac St. Lawrence se situait dans sa moyenne, alors que celui du lac Saint-Louis était de 22,12 m, soit 78 cm au-dessus de sa moyenne. Au port de Montréal, le niveau d’eau était de 83 cm au-dessus de sa moyenne.
Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent précise le débit du lac Ontario en conformité avec le Plan 2014, comme il est prescrit dans l’ordonnance supplémentaire de 2016 de la Commission mixte internationale.
Les États-Unis et le Canada ont convenu du Plan en décembre 2016 pour tenter d’améliorer la performance environnementale tout en conservant la plupart des avantages qu’apportait aux autres parties prenantes le Plan 1958-D, en vigueur précédemment depuis 1963. Afin de déterminer le débit, le Conseil et son personnel suivent de près le niveau d’eau du réseau hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent ainsi que des Grands Lacs d’amont, de même que les effets qu’a ce niveau sur les intervenants de tout le bassin.
Des renseignements plus détaillés se trouvent sur le site Web du Conseil, à l’adresse suivante : http://ijc.org/fr_/islrbc.
***
Vous aimez cet article! Faites une DONATION à la rédaction du cyberjournal par un clic au bas de la colonne de droite de cette page... MERCI