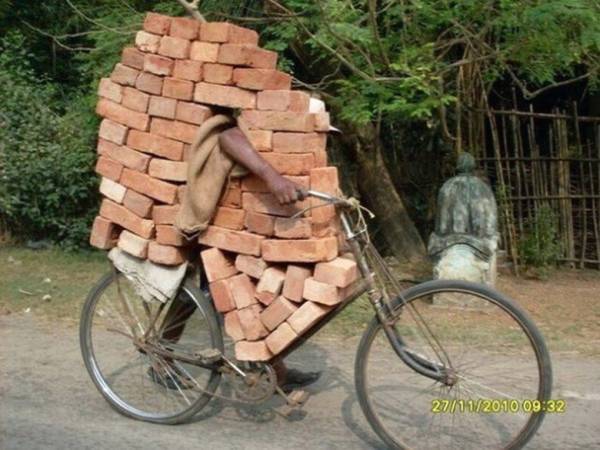« Il n’y a pas de personne incompétente, il n’y a que des personnes à la mauvaise place! »
Le président-fondateur d’Atman Co., Michel Guay, solutionne peut-être facilement la problématique de la gestion des ressources humaines en entreprise ou ailleurs. Son expérience, et surtout son expertise, invitent à l’écoute: il est le créateur d’un test psychométrique de reconnaissance d’aptitudes ayant une validation scientifique convaincante auprès d’un échantillonnage de plusieurs milliers de personnes dans différentes sphères d’activités mondiales.
Ledit Atman, qui est aussi le nom du test, n’a aucune connivence avec la vedette du cinéma! Atman est cependant un super test, qui l’on peut faire en 10 ou 30 minutes selon l’option choisie, permettant d’évaluer les réflexes naturels d’un individu et de maximiser l’adéquation entre son potentiel et les fonctions ou défis à lui confier. On pourrait résumer que chacun de nous est un Superman à la recherche de sa place idéale sous le soleil. De bien se connaître, maîtriser son caractère et ses aptitudes, aide à trouver sa place dans le monde.
À écouter la suite d’anecdotes positives que raconte Michel Guay, il suffit de l’essayer pour finir de se convaincre de la pertinence de la démarche, et ce en toutes occasions. Voire pour aider votre adolescent à s’orienter au mieux, à travers son passage dans le monde de l’éducation. Le plus bel avantage d’Atman est probablement d’être une plate-forme totalement intégrée sur le web.
EN BOURSE À SA FONDATION
Et lorsqu’il fonda Atman Co., il y a trois ans, l’homme d’affaires savait tellement qu’il devrait réaliser une stratégie de croissance rapide et d’acquisitions, notamment à l’international, qu’il a vite fait d’inscrire sa société en Bourse. Il a ainsi récolté 2 millions $ avec le premier appel public à l’épargne (PAPE). On était en décembre 2012.
En fait, la confiance était plus que de mise, car Atman Co. fut l’une des très rares entreprises québécoises à s’inscrire en Bourse cette année-là!
Amorçant, à Québec, le 12 juin 2015, une tournée des investisseurs dans le cadre d’un lunch devant une vingtaine d’invités à l’Hôtel ALT, Michel Guay a expliqué qu’il vient de récolter un autre 2 M$ grâce à une nouvelle émission à 0,18$ par action. De quoi permettre à l’entreprise de Montréal, comptant une quinzaine d’employés, la poursuite de son développement et de sa stratégie de commercialisation. Et ce dernier mot est ici plus qu’important, car Atman Co. doit se développer en comptant essentiellement sur sa quête de parts de marché. Le produit est là, un produit 100% web, un test de 6e génération en gestion RH qui évalue les réflexes naturels d’un individu, et comme l’a clairement reconnu son créateur, ce n’est pas en le perfectionnant qu’il compte brasser plus d’affaires.
TROUVER LES MEILLEURS PARTENAIRES POSSIBLES
La stratégie d’affaires est simple, elle consiste à nouer des partenariats stratégiques. Et le potentiel est bien là : c’est surtout ce qu’il était venu démontrer à son assistance. Précisant que l’entreprise offre des licences d’utilisation depuis l’an dernier, brevet en poche, version API AtmanConnect pleinement fonctionnelle, 6 langues offertes aux usagés… Michel Guay voit l’avenir avec un sourire aux lèvres :
« On va devenir le premier outil du genre dans SalesForce. »
Les autres manifestations d’intérêts pour le test de personnalité Atman sont effectivement diversifiées: les sites de rencontre sur internet (« Il n’y a que EliteSingles qui comporte un volet test actuellement », confirme-t-il), le secteur du gaming (casino), l’événementiel (des organisateurs de congrès qui offrent le test à leurs participants); et parfois surprenantes : les équipes sportives! Ici c’est pour mieux gérer les espoirs et talents en apparence, avant de trop investir. L’athlète est-il du genre à résister devant le stress intense ou bien il va carrément s’effondrer? C’est bon à savoir, si l’on pense avoir le prochain Wayne Gretzky devant soi!
Et ça coûte combien, se payer un test Atman?
Il y a des forfaits à la quantité et pour les licences également, mais c’est 125$ le test sur une base individuelle.
Qu’est-ce qu’un test de 6e génération? C’est un test normalisé, disons très « user frendly » et qui ne nécessite pas de recourir à un expert ou un psychologue pour l’analyse des résultats.
Dans des économies qui se spécialisent de plus en plus vers les secteurs tertiaires et quaternaires, qui offrent essentiellement des services, les entreprises des pays développés doivent pouvoir compter sur une main-d’oeuvre coupée au couteau… Et trouver son Superman semble encore une préoccupation qui cause problème à bien des patrons, car la start-up en RH fait partie des tendances (trends) actuelles dans le monde du capital de risque, selon les confidences de notre conférencier ce midi-là!
La concurrence de manquera pas pour Atman Co. La plus belle force cachée de cette entreprise québécoise réside déjà dans sa capacité à conserver avec sa base de données tous les résultats accumulés des tests vendus. Une capacité d’analyse et de partages d’expertises bien repérée par plusieurs futurs partenaires rencontrés. À suivre…
Avant de vous laissez, vous vous demandez vous aussi ce que signifie ce mot?
ATMAN: (Hinduism, Buddhism, Jainism, Vedanta)
The true self of an individual beyond identification with phenomena, the essence of an individual.