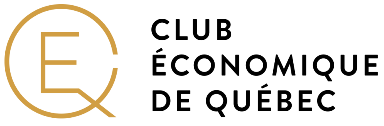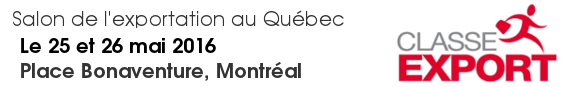L’analyste passionné de politique américaine John Parisella était l’invité du Club économique de Québec le 15 avril. La campagne pour l’élection présidentielle de novembre 2016 est loin de sa conclusion, mais les explications de ce fin observateur avaient beaucoup de bons.
Il a d’abord prévenu que la relation Canada-USA n’était pas ici en jeu, comme généralement dans toutes les campagnes. Ce n’est jamais la personne en poste à la Maison Blanche qui détermine vraiment les fondamentaux des relations entre les deux pays, assure M. Parisella.
Ceci dit, il y aura des impacts selon le choix de novembre : « Si les Démocrates sont élus, oubliez le projet Keystone ! ».
John Parisella n’a pas explicitement fait de prévisions, mais il a révélé des cheminements possibles de la suite des choses dont personne ne parle présentement.
Certes, il pense sans surprise que madame Clinton remportera la candidature pour les Démocrates. Il a rappelé aussi que tous les sondages la donnent gagnante devant Trump ou Cruz.
Mais il a expliqué un scénario alternatif.
« Si M. Trump ne l’emporte pas au premier tour, chez les Républicains la candidature pourrait bien se jouer sur le plancher du congrès à l’investiture et c’est l’actuel président du Congrès, rappelons qu’il est le numéro 3 du système politique des USA, un homme respecté de l’establishment, qui pourrait bien venir brouiller les cartes et devenir le candidat idéal pour affronter madame Clinton. »
« Un des éléments qui fait peur aux Républicains avec Trump c’est de perdre la majorité au Sénat », analyse aussi John Parisella.
À suivre !
M. Pierre Drapeau, président du Club économique de Québec, en compagnie du conférencier, M. John Parisella.