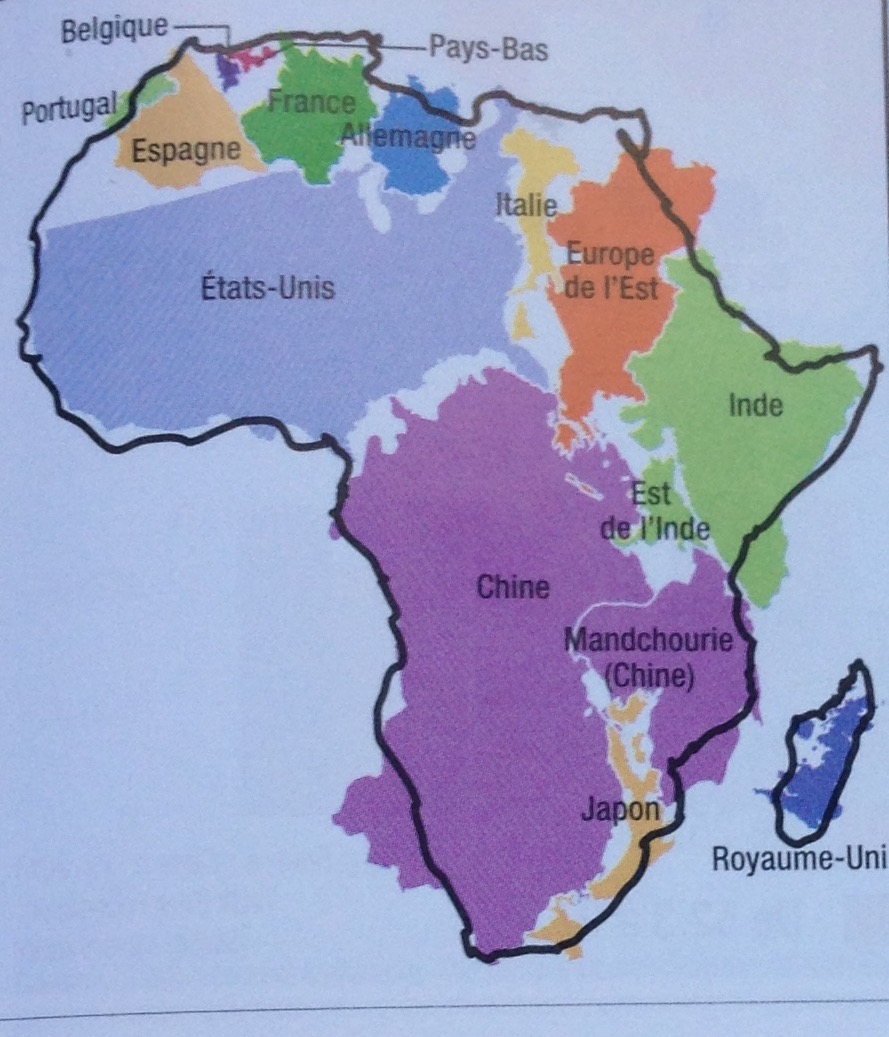La même semaine qui voyait le maire Denis Coderre accueillir sur l’île de Montréal une délégation de gens d’affaires des Iles-de-la-Madeleine pour brasser des affaires d’une île à l’autre, près de 200 personnes ont su profiter de la journée du 21 octobre 2015 dédiée au maillage d’affaires grâce au 1er Forum interindustriel.
C’est à l’initiative de l’Association des industriels d’Anjou (AIA) que le rendez-vous était donné sous la thématique: «La création d’affaires interindustrielles à son meilleur !» Tenue au Centre des Congrès et Banquets Renaissance d’Anjou, la première édition du Forum interindustriel a permis à quelque 60 exposants de l’est de Montréal, Anjou, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord et Montréal-Est de rayonner sur la communauté d’affaires régionale. Kiosques, conférences, speed nerworking et plusieurs généreux prix de présence ont animé la journée. Bref, un succès qui a permis aux organisateurs d’annoncer, sans attendre, le retour d’une seconde édition du Forum interindustriel, en octobre 2016.
En quoi le concept d’affaires interindustrielles peut-il aider la métropole économique du Québec à se dynamiser davantage ? Hormis l’original épisode de speed nerworking du programme de la journée, il s’agissait-là d’une activité de gens d’affaires habituelle.
« En organisant ce 1er Forum j’ai compris l’importance de faire encore plus devant le besoin de nos entreprises de partager leurs défis, de mieux se faire connaître, de s’ouvrir à de nouvelles opportunités, de travailler davantage ensemble et de sortir de leur silo », nous explique la directrice générale Sâadia Lakehal en faisant écho à ce qu’elle a entendu des entrepreneurs en les visitant un à un ces derniers mois.
« Multiplier les échanges. » Voilà donc le mot d’ordre derrière l’initiative de créer, sur la lancée du 1er Forum interindustriel, l’Association inter industriels de Montréal (AIIM). Une nouvelle association qui a été saluée par la mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, madame Chantal Rouleau, ainsi que par la présence de ses collègues de Montréal-Nord et de Montréal-Est lors du forum.
En décidant de changer la vocation de l’Association des industriels d’Anjou pour en faire l’Association inter industriels de Montréal (AIIM), madame Sâadia Lakehal se mettra dorénavant au service de tous les industriels, et du coup des parcs industriels de Montréal, en priorisant l’échange entre les industriels.
Les « sortir de leur silo » sera-t-il suffisant ?
Dans la foulée du dernier ralentissement économique mondial, le Québec a vu disparaître le tiers de ses entreprises manufacturières. « De 20 000 qu’elles étaient, il y a quelques années encore, on en dénombre actuellement environ 12 600 », d’expliquer lors de sa conférence du 21 octobre sur l’usine du futur, Jean-Pierre Dubé, président de JPD Conseil, en précisant qu’en général « elles sont 25 à 40 % moins performantes que la moyenne des entreprises canadiennes et 50% moins que celles aux USA. »
Une situation dramatique à moyen terme dont personne ne parle suffisamment!
L’AIIM se donne comme mission d’améliorer leur productivité en les faisant davantage échanger entre elles. D’ici janvier 2016, en collaboration avec Biz-Biz, une plateforme internet de partage des actifs dormants sera fonctionnelle comme nouveau service pour les industriels. La sensibilisation face aux opportunités de l’économie circulaire est aussi prévue.
Améliorer les collaborations entre les divers parcs industriels de Montréal semble le point de force de la vision interindustrielle de cette algérienne d’origine, chimiste et biologiste de formation, douée d’un dynamisme contagieux. Bravo madame Sâadia !
Sur la photo : R. Coutu, M. Zammit, S. Beauchemin, C. Rouleau, S. Polidoro, S. Lakehal, G. Déguire, M. Guedes.