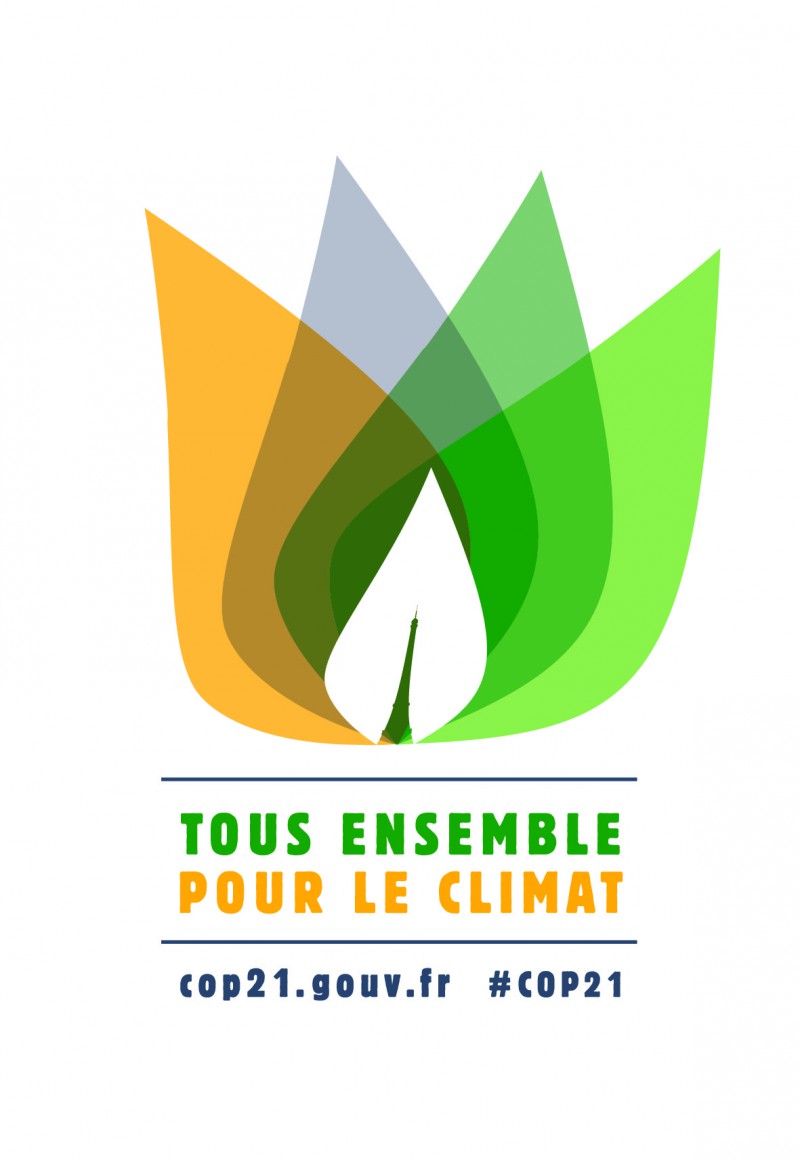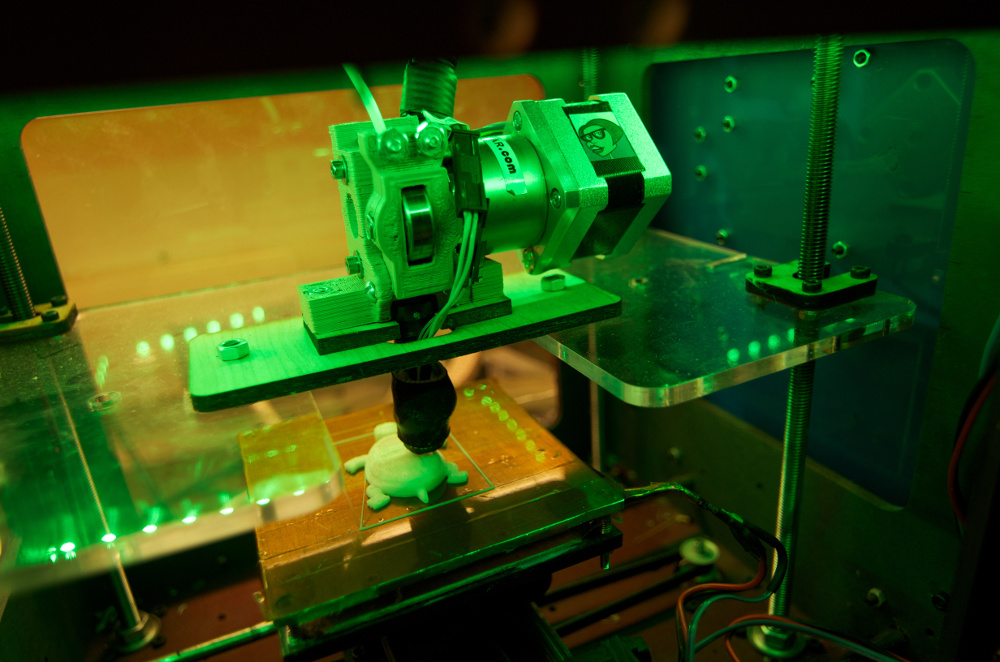Les cas plus connus furent évidemment Hong Kong et Macao. La Chine en a aujourd’hui récupéré la complète souveraineté, après les célèbres 99 ans d’attente dans le premier cas. Peu de gens maîtrisent l’histoire de l’île de Diego Garcia que le Royaume-Uni loua en 1966 aux États-Unis pour une période de cinquante ans… soit jusqu’en 2016. Nous y sommes!
C’est lors d’un accord secret Royaume-Uni / États-Unis, entre le premier ministre Harold Macmillan et le président John F. Kennedy, que Washington prenait l’engagement d’installer une base militaire dans cette région « afin de défendre les intérêts du monde occidental ». C’était au début des années 1960 et pour ce faire il fallait cependant que le territoire britannique désigné échappe au processus de décolonisation et que sa population en soit évacuée. À la suite de ces tractations politiques, le gouvernement britannique créa donc le BIOT (British Indian Ocean Territory) par un décret-loi (Order in Council) en date du 8 novembre 1965. Dès lors, l’ensemble d’îlots devenait officiellement un territoire britannique d’outre-mer séparé de Maurice, qui elle était en route vers son indépendance.
Plus précisément, Londres fit «accepter» la transaction aux Mauriciens, c’est-à-dire la perte de souveraineté sur Diego Garcia, en en faisant l’une des conditions imposées pour accéder à l’indépendance, qui surviendra en mars 1968. Par la suite, le gouvernement britannique offrit à l’île Maurice une compensation de quatre millions de livres comme «règlement complet et définitif». Puis officiellement en 1966 le Royaume-Uni loua l’île de Diego Garcia aux États-Unis pour une période de cinquante ans, renouvelable…
L’article 11 du traité précisait ce qui suit:
(Article 11) Le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Royaume-Uni prévoient que les îles resteront disponibles pendant un laps de temps indéterminé afin de répondre aux besoins éventuels des deux gouvernements en matière de défense. En conséquence, après une période initiale de 50 ans, le présent accord demeurera en vigueur pendant une période supplémentaire de 20 ans, à moins qu’un des deux gouvernements, deux ans au plus avant la fin de la période initiale, notifie à l’autre sa décision d’y mettre fin, auquel cas le présent accord expirera deux ans après la date de cette notification.
L’année 2016 devenait donc une date charnière, fin du bail de 50 ans, accordé par les Britanniques en 1966. Mais l’histoire n’avait pas prévu les années 2000…
En 2001, l’île de Diego Garcia comptait déjà quelque 1 500 militaires, plus 2 000 civils, dont un grand nombre de travailleurs agricoles. Presque toute la population étant non résidente. Le territoire restant administré par un commissaire qui réside à Londres et dépend du Foreign and Commonwealth Office. Ce dit commissaire est représenté à Diego Garcia par un officier de la Royal Navy.
Puis vint la crise terroriste, le 11 septembre, les bombardements en Afghanistan…
Pour Washington, Diego Garcia compte dorénavant parmi les bases militaires les plus importantes au monde. S’y abritent une flotte de bombardiers (B-2 et F-111) et des sous-marins nucléaires; quelque 1 700 militaires et 1 500 civils d’origine américaine, mauricienne, sri lankaise et philippine y travaillent sous contrat.
Le journaliste britannique du Sunday Telegraph, Simon Winchester, a visité Diego Garcia en novembre 2001 et il en est arrivé à la conclusion qu’il s’agissait de la plus grosse base militaire américaine du monde.
L’année de bail 2016 changera-t-elle quelque chose?
Selon Wikipédia : Diego Garcia occupe une position stratégique dans le centre de l’océan Indien. L’atoll est situé à 2 000 kilomètres de l’Inde, à 3 500 kilomètres des côtes orientales de l’Afrique et de l’Indonésie, à 4 500 kilomètres du golfe Persique et à 5 000 kilomètres des côtes occidentales de l’Australie. Il est situé au croisement des routes maritimes reliant l’Extrême-Orient à l’Europe aussi bien via le canal de Suez que par le cap de Bonne-Espérance et les pétroliers sortant du golfe Persique croisent au large de Diego Garcia quelle que soit leur destination et notamment en direction de l’Asie. La construction de la base militaire débuta en 1971 et est dite opérationnelle depuis 1986.
L’ESPOIR DE LA CONVENTION DES DROITS DE LA MER
Autant le gouvernement de Maurice que les Chagossiens expulsés des lieux contestent le statut imposé.
Dans une lettre datée du 1er juillet 1992 adressée aux autorités mauriciennes, le gouvernement britannique a soutenu que la souveraineté sur l’archipel serait rendue à Maurice lorsque la base militaire de Diego Garcia « ne serait plus nécessaire à la défense de l’Occident ». Une position qui laisse place à bien des interprétations.
Les États-Unis ont fait savoir qu’ils s’opposeraient catégoriquement au retour des Chagossiens à Diego Garcia, et ce, aussi longtemps que ce territoire insulaire serait « utile aux intérêts des puissances occidentales ».
Et le 22 octobre 2008, les cinq arbitres de la Chambre des lords (les Law Lords) ont rendu un jugement en faveur du gouvernement britannique, estimant que la Grande-Bretagne avait vidé l’archipel des Chagos pour des raisons politiques et qu’ils n’avaient pas à évaluer le bien-fondé de sa démarche.
Des études britanniques ont aussi révélé qu’en raison du réchauffement climatique la montée de l’océan entraînerait à moyen terme la quasi-disparition de Diego Garcia…
Mais ça bouge aussi selon justement le droit de la mer : 50 ans après « l’excision unilatérale et arbitraire » de l’archipel des Chagos du territoire mauricien par les colons anglais, le Ruling de la Permanent Court of Arbitration sous la Convention des Droits de la Mer, qui a siégé en mai 2014 à Istanbul, est venu donner raison à Maurice dans ses droits.
- La création de la Marine Protected Area (MPA) aux Chagos par Londres sans le consentement de Maurice et unilatéralement n’est pas légale.
- Les droits de Maurice sur les eaux territoriales, les droits de pêche et d’exploitation des fonds marins des Chagos sont validés par le jugement d’Istanbul.
Le jugement de 227 pages sur le Marine Protected Area aux Chagos, excluant la base américaine de Diego Garcia, constitue donc une avancée historique pour Maurice dans sa revendication pour son intégrité territoriale. Même si la majorité des cinq juges siégeant ne se retrouvent pas sur la même longueur d’ondes concernant la question de la souveraineté de Maurice sur les Chagos, le jugement du 18 mars dénonce l’illégalité de la Grande-Bretagne dans la création de la Marine Protected Area aux Chagos, vu que les droits et intérêts souverains de Maurice ont été bafoués et violés. Toutefois, les critiques les plus acerbes contre la Grande-Bretagne ont été formulées dans un Dissenting Judgment minoritaire signé des juges James Kateka et Rüdiger Wolfrum, qui dressent un parallèle entre l’excision des Chagos du territoire mauricien, en 1965, et le projet unilatéral de Londres avec le MPA, visant à priver Maurice de ses droits sur les eaux territoriales aux Chagos, ainsi que de ses droits de pêche et d’exploitation du fond marin de l’archipel.
Diego Garcia, l’île principale de l’archipel des Chagos, fera-t-elle l’objet un jour d’un accord tripartite entre Maurice, le Royaume-Uni et les États-Unis?
La loi des eaux et du climat réglera probablement une large partie de l’affaire avant le Droit de la mer. Le point culminant de l’archipel des Chagos se trouve sur Diego Garcia avec une altitude de 15 mètres, un relief qui tranche avec la majorité de l’île et le reste de l’archipel dont l’élévation ne dépasse généralement pas 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et Diego Garcia reste un atoll en fer à cheval formé d’une île principale et de trois petits îlot comptant que 28 km2 de superficie (44 km2 de superficie totale lagon inclus).
Et le renouvellement du bail court maintenant jusqu’en 2036.