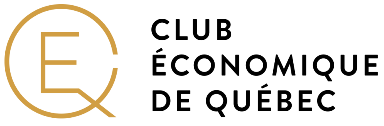| Nous reproduisons ici le texte de présentation et de mise en contexte de la prochaine édition du Forum économique international des Amériques – Conférence de Montréal, qui aura lieu pour une 22e année, du 13 au 16 juin 2016. Il est signé de son fondateur Gil Rémillard. La pertinence de sa lecture des enjeux de l’heure et à venir nous apparaît comme une lecture incontournable.
La rédaction
|
Par Gil Rémillard
Président-fondateur
Forum économique international des Amériques
Le 21e Forum économique international des Amériques – Conférence de Montréal, qui a eu lieu du 8 au 11 juin 2015, a été un grand succès. Plus de 3500 participants, dont de nombreuses délégations étrangères, ont pu recevoir une information exceptionnelle de la part de quelque 195 conférenciers et intervenants du plus haut niveau. La couverture médiatique de la Conférence a permis de rejoindre quelque 61 millions de personnes sur les cinq continents.
Dans leurs mots de conclusion, le président et chef de la direction, Nicholas Rémillard, et la présidente du Comité d’orientation stratégique, Hélène Desmarais, Présidente du conseil et chef de la direction, Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM), ont annoncé que la 22e édition de la Conférence aura lieu du 13 au 16 juin 2016, sous le thème général : «Construire une nouvelle ère de prospérité».
MISE EN SITUATION
Ce thème a été choisi par le Bureau des gouverneurs, sous la présidence de Paul Desmarais Jr, Président du conseil et co-chef de la direction, Power Corporation du Canada, lors de sa réunion annuelle du 8 juin dernier. Il s’inscrit dans la suite des dernières conférences qui nous ont permis de dégager les grandes perspectives actuelles d’évolution de l’économie mondiale.
En effet, les deux dernières Conférences nous ont permis, tout d’abord avec celle de 2014 qui avait pour thème général «Les fondements de la prochaine ère de croissance», de bien comprendre que nous nous sommes engagés dans un deuxième cycle de la mondialisation des économies, ce qui, comme l’a démontré la dernière Conférence de juin 2015 dont le thème était «Bâtir une économie équilibrée», nous oblige à faire certains ajustements importants en recherchant davantage d’équilibre et d’équité dans le développement économique mondial.
Ainsi, nous avons pu comprendre que pendant le premier cycle de mondialisation allant de 1995, avec la création de l’OMC, jusqu’à la « Grande récession » de 2008, l’interdépendance qui s’est développée entre les États, accompagnée d’exigences croissantes, a formé un véritable rempart contre le mauvais protectionnisme. Nous pouvons même penser que lors de la crise économique et financière de 2008, les États auraient pu se lancer dans une série de mesures beaucoup plus protectionnistes, s’ils n’avaient pas compris qu’ils se seraient alors exposés aux effets « boomerang » découlant de cette interdépendance des économies qu’a créée la mondialisation. Grâce à ce rempart et aux politiques audacieuses des principales banques centrales, nous avons pu éviter une sévère dépression du type de celle des années 1930.
De plus, le premier cycle économique de la mondialisation a favorisé l’émergence des pays du Sud, tant du continent africain que de l’Asie et de l’Amérique latine, essentiellement sous l’impulsion du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Les pays émergents représentent aujourd’hui 52 % de la production industrielle et 34 % de la demande mondiale. Ainsi, l’écart de la richesse entre le Nord et le Sud a été réduit d’un tiers. Cependant, l’éclatement des grandes bulles spéculatives dans les pays du Nord et la « Grande récession » de 2008 qui s’en est suivie ont causé une forte augmentation des dettes publiques et privées dans les pays développés, amenant dans leur foulée austérité et chômage, ainsi qu’une forte diminution de la confiance chez les investisseurs et chez les consommateurs.
Aujourd’hui, l’économie mondiale, huit ans après la « Grande récession », est toujours incertaine alors que 10 grandes questions nous interpellent :
- Le ralentissement de l’économie chinoise peut-il remettre en cause un « atterrissage en douceur » de la deuxième économie en importance du monde ?
- À quelles conditions l’économie américaine peut-elle résister et poursuivre sa croissance ?
- Comment l’Europe peut-elle surmonter ses difficultés géopolitiques pour reprendre le chemin d’une croissance durable ?
- Quels sont les véritables impacts économiques de la chute des prix de l’énergie et des matières premières ?
- Après l’année la plus chaude qu’ait connue la planète (2015), quelles peuvent être les effets sur l’économie mondiale des changements climatiques et des cataclysmes naturels qu’il peut engendrer ?
- Jusqu’où le manque de confiance amènera-t-il la volatilité des marchés et la diminution des investissements ?
- Comment doit-on gérer la quatrième révolution industrielle afin qu’elle soit source de croissance et de prospérité pour l’humanité ?
- Quelles sont les sources de conflit les plus dangereuses pour la paix mondiale et pour un développement économique gage de prospérité à l’échelle internationale ?
- Comment peut-on garantir l’accessibilité de l’innovation dans le secteur de la santé ?
- Comment les pays émergents, et en particulier ceux du BRICS, peuvent-ils s’engager dans le chemin d’une prospérité mondiale ?
LES 3 GRANDES RÉVOLUTIONS
Ces questions sont au cœur de l’évolution de l’économie mondiale et sont significatives des conséquences d’une fin de premier cycle qui a donc été plus difficile pour les pays du Nord, mais tout de même positive pour ceux du Sud, malgré les ajustements importants auxquels ils sont aujourd’hui confrontés pour s’adapter aux réalités de ce deuxième cycle de la mondialisation de l’économie. C’est ainsi que nous devons composer avec une économie globale incertaine fortement touchée par les sérieux problèmes de ralentissement de croissance de la Chine et les effets contraignants de trois révolutions majeures qui ont lieu en même temps pour l’ensemble de la planète :
- La révolution nanotechnologique, qui propulse une quatrième révolution industrielle avec, entre autres, l’utilisation de plus en plus répandue de la robotique, de l’impression 3D et de nouveaux matériaux. La sous-traitance à l’étranger (« outsourcing »), qui a beaucoup contribué à l’émergence de pays comme la Chine, va considérablement diminuer, laissant la place à la fabrication par impression 3D, et ce, dans les pays d’origine des produits, ce qui permettra aux entreprises un contrôle des coûts plus serré, une productivité accrue et une qualité plus constante;
Selon l’OCDE, d’ici 2030, la moitié des emplois existants auront disparu ou auront été remplacés par d’autres, basés sur de nouveaux procédés.
- Une révolution de l’énergie, fondée principalement sur l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste et sur l’énergie solaire, liée à la nouvelle capacité d’emmagasiner l’énergie des batteries, de même que l’énergie éolienne, sources d’énergie alternatives qui peuvent, notamment, faire des États-Unis des exportateurs d’énergie et qui affectent, par la chute des prix qu’elles engendrent, les pays émergents comme les pays développés qui ont construit des modèles économiques fondés principalement sur l’exploitation des sources d’énergie fossile;
- Une révolution des communications ouvrant un accès direct à une multitude d’informations et à une communication instantanée entre les personnes, créant ainsi de nouveaux mouvements sociaux. Ces derniers sont devenus un véritable phénomène de société, cette communication directe, qui se passe d’infrastructures, ouvrant un accès nouveau à l’information et à l’éducation, en particulier pour les pays du Sud. De plus, Internet transforme en profondeur les moyens de gestion, y compris la mise en marché et la vente des produits, qui se fait de plus en plus directement au consommateur, qui n’a pas à se rendre chez le vendeur.
VERS UNE NOUVELLE PROSPÉRITÉ MONDIALE PAR L’INNOVATION
« The lives of people in poor countries will improve faster in the next 15 years
than at any other time in history. And their lives will improve more than anyone else’s. »
Bill et Melinda Gates dans leur bulletin annuel du 22 janvier 2015.
Les impacts de ces révolutions si significatives sur le plan économique autant que politique et socioculturel nous engagent dans une période d’évolution où il faut désormais innover et se référer davantage aux « perspectives de prospérité » qu’au « taux de croissance » pour assurer un développement durable de la planète.
En effet, tous les intervenants, que ce soit au World Strategic Forum de Miami en avril qu’à la Conférence de Montréal de juin ou au Toronto Global Forum de juillet dernier, ont fait valoir que le nouveau cycle économique de la mondialisation des économies sera marqué par de faibles taux de croissance pour les pays industrialisés. Quant aux pays émergents, en particulier ceux du BRICS, leurs taux de croissance devraient diminuer de façon marquée en comparaison avec ceux qu’ils ont connus pendant le premier cycle de la mondialisation. Cependant, cela ne veut pas dire que la qualité de vie ne continuera pas de s’améliorer.
Bien au contraire: la formation et l’éducation par les nouveaux moyens de communication sont beaucoup plus accessibles partout, en particulier dans les pays en voie de développement; les nouvelles découvertes, notamment en ce qui concerne les vaccins et la robotique médicale, améliorent considérablement la qualité de vie et permettent de combattre de plus en plus efficacement les épidémies et plusieurs maladies endémiques; la robotique permet d’améliorer sensiblement les conditions de travail; l’énergie, d’une qualité croissante, est de plus en plus accessible, sous différentes formes et à des prix plus abordables; enfin, la solidarité qui s’est dégagée du COP21 de Paris sur le climat, en décembre dernier, nous permet d’espérer une perception de la croissance et une détermination nouvelles pour un développement durable sur les cinq continents.
Il s’agit donc essentiellement d’orienter la croissance mondiale dans une perspective de développement plus conforme aux nouvelles réalités et aux nouvelles possibilités humaines:
« Comment peut-on développer une meilleure qualité de vie pour l’ensemble de la planète dans le contexte d’une économie aux taux de croissance modeste, mais capable, sous l’effet de l’innovation, de soutenir une évolution humaine exceptionnelle ? »
Voilà la question de base qui servira de référence première pour la préparation du programme de la 22e Conférence de Montréal, qui aura lieu du 13 au 16 juin 2016, et de ceux du World Strategic Forum de Miami (11-12 avril 2016) et du Toronto Global Forum (12-14 septembre 2016), qui célèbrera cette année son 10e anniversaire. Cette question de base est d’autant plus stimulante lorsqu’on ajoute à l’impact des trois grandes révolutions celui des nouvelles routes commerciales qui se mettent en place, reliant les cinq continents.
LES 3 GRANDES ROUTES INTERNATIONALES DE COMMERCE EN DÉVELOPPEMENT
C’est en effet dans ce contexte de prospérité qu’il faut voir les trois nouvelles routes intercontinentales de commerce qui se mettent en place actuellement:
- La route de l’Asie, qui fait l’objet de discussions pour la formation d’une zone de libre-échange à laquelle pourraient se joindre, notamment, les pays de l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) et potentiellement la Chine et l’Inde. Le canal de Suez, récemment adapté aux nouvelles conditions du transport maritime, pourrait donner une impulsion majeure à cette nouvelle route commerciale.
- La route du Pacifique : Le Partenariat Transpacifique comprend à ce jour 12 pays, dont les États-Unis, le Japon et le Canada. Le « fast-track » que vient d’obtenir du Congrès américain le président Obama et l’aboutissement des négociations d’Atlanta, le 5 octobre dernier, ainsi que la signature officielle des 12 pays le 4 février, constituent autant de perspectives de développement de nouveaux marchés pour l’ensemble des pays signataires, qui pourraient éventuellement comprendre la Chine ;
- La route de l’Atlantique : elle s’inscrit dans la foulée de la signature du traité de libre-échange Canada – Union européenne de 2014 ainsi que des discussions avancées que l’Union européenne poursuit avec les États-Unis, les pays du Mercosur, ainsi que certains pays de la côte atlantique de l’Afrique. Le Mexique a été le premier État des Amériques à signer en 1994 un traité de commerce avec l’Union européenne. De plus, le nouveau canal de Panama permet un accès direct considérablement amélioré au Pacifique. D’autres canaux, financés principalement par des investissements chinois, notamment au Nicaragua, pourraient d’ici les 10 prochaines années venir compléter les voies de communication de transport maritime particulièrement stratégiques entre l’Atlantique et le Pacifique.
LA RÉFORME DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
D’ici environ cinq à dix ans, ces grandes routes de commerce international devraient pouvoir servir l’ensemble des ententes de libre-échange, tant bilatérales que régionales, qui existent sur tous les continents. Il reste à déterminer quel rôle l’Organisation mondiale du commerce devrait jouer pour assurer l’application des règles de base du multilatéralisme, et comment nous pouvons lui donner l’impulsion nécessaire pour qu’elle puisse surveiller et gérer le commerce international, actuellement en régression sous l’effet, entre autres, de la diminution de la délocalisation et du ralentissement économique mondial.
Les consensus obtenus en juillet 2015 sur le difficile problème de la propriété intellectuelle dans le secteur technologique peuvent nous donner espoir pour la suite des choses. En effet, l’abolition des droits de douane sur quelque 200 produits de haute technologie, dont les GPS, les appareils IRM et autres écrans tactiles, devraient amener leur prix à baisser notablement. Selon le directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, il s’agit du premier accord douanier majeur depuis 18 ans. Les discussions sur les aspects de la propriété intellectuelle autres que ceux liés à l’agroalimentaire, autre sérieux problème dans toute négociation de libre-échange, pourront être éventuellement reprises dans un contexte dorénavant plus positif.
Il faudra également revoir le rôle de certains autres organismes internationaux, notamment le FMI (Fonds monétaire international) pour protéger la stabilité financière mondiale en surveillant de plus près la fluctuation de la valeur des monnaies, principalement sous l’effet de leur manipulation par les États; la Banque mondiale, en ce qui concerne l’ajustement de ses politiques de développement au moyen d’une coordination avec les nouvelles institutions asiatiques (la New Development Bank (NDB) et l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)); l’ONU (Organisation des Nations Unies) pour les questions liées à la géopolitique et aux conflits armés qui sont, avec le terrorisme, l’une des menaces les plus sérieuses contre la croissance économique et la prospérité; la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture), pour l’agroalimentaire qui devient un enjeu de plus en plus crucial pour l’humanité, surtout dans le contexte du réchauffement climatique; l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), pour la propriété intellectuelle et les défis qu’elle représente pour la recherche et l’accessibilité des nouvelles technologies; l’OMS (Organisation mondiale de la santé), qui doit pouvoir nous protéger contre les épidémies et les pratiques dangereuses pour la santé, comme l’utilisation de certains pesticides; et l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), pour développer ce nouveau sens de l’humanisme qui semble émerger du contexte mondial économique et financier comme du contexte interculturel en réaction à la barbarie des « guerres de religion ».
LA MISSION DU FORUM ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL DES AMÉRIQUES
Il apparaît donc essentiel de communiquer au secteur privé comme au secteur public et aux intervenants de la société civile l’information pertinente et, surtout, de leur donner des occasions privilégiées de se rencontrer et d’en discuter, en invitant les gouvernements et les organisations internationales à participer.
Voilà la mission que s’est donnée le Forum économique international des Amériques, fondé en 1995, et qui organise chaque année trois forums internationaux, lesquels se tiendront en 2016 sous les thèmes généraux suivants en relation avec la prospérité :
– Le World Strategic Forum de Miami (du 11 au 12 avril 2016) : «Pioneering for Growth and Prosperity»;
– La Conférence de Montréal (du 13 au 16 juin 2016) : «Construire une nouvelle ère de prospérité»;
– Le Toronto Global Forum (du 12 au 14 septembre 2016) : «Leading in Uncertain Times».
La situation économique actuelle est significative de l’évolution de l’humanité. L’histoire nous démontre qu’environ tous les 100 ans, nous vivons une période « révolutionnaire » sous l’effet du progrès et de l’évolution humaine, et aussi des circonstances environnementales. Nous avons ainsi appris de l’histoire certaines leçons de base qui nous ont permis, lors de la « Grande récession » de 2008, d’éviter une crise semblable à celle de 1929, voire pire. Nous savons dorénavant que « le laissez-faire » n’a plus sa place dans la gestion publique que ce soit sur le plan économique ou sociopolitique. Imprimer de l’argent et abaisser les taux d’intérêt, c’est une chose, gérer la révolution industrielle et tirer parti de celles des communications et de l’énergie pour assurer la prospérité de la planète, c’en est une autre.
Nous devons faire preuve de leadership. Voilà probablement la principale lacune à laquelle nous devons faire face actuellement. Nous avons devant nous un très difficile casse-tête, car les pièces sont nombreuses et complexes. Mais sa plus grande difficulté, c’est que nous n’avons pas sous les yeux l’image que devrait donner le rassemblement de toutes ses pièces. Non seulement cela nous prend beaucoup plus de temps pour trouver la bonne pièce, mais encore arrive-t-il que nous fassions, de bonne foi, l’erreur de forcer une pièce qui n’est pas la bonne, avec les problèmes qui s’ensuivent.
Nous devons donc au premier chef nous entendre sur la vision du développement que nous voulons pour la planète. Ensuite, il sera d’autant plus possible de prendre les moyens nécessaires pour y arriver. En ce sens, le succès du COP21 de Paris de même que l’évolution prometteuse des discussions sur la Syrie et la signature du Partenariat transpacifique (Trans-Pacific Partnership, TPP) sont des plus significatifs pour nous ouvrir la voie de la solidarité des peuples et des continents nécessaire pour mettre en place les fondements d’une nouvelle ère de prospérité. C’est dans ce contexte que le Forum économique international des Amériques (FEIA) veut offrir sa contribution en rassemblant dans ses trois événements de 2016, à Montréal, Toronto et Miami, quelque 400 intervenants-conférenciers et plus de 7 500 participants.
—
Nous remercions M. Rémillard pour sa pertinente analyse.
forum-ameriques.org/montreal/2016